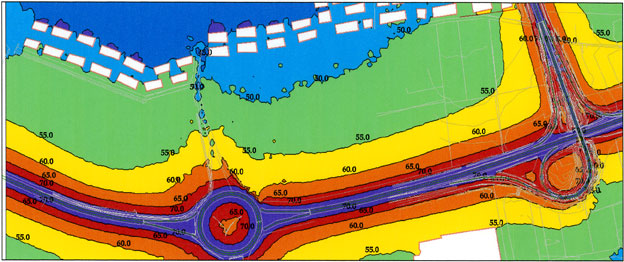Vendargues
Étude d'entrée de ville sur la R.N. 113
(Application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme)
(septembre 2005)
Vers section précédente
Paysage
PAYSAGE ET CIRCULATION sur la nationale 113
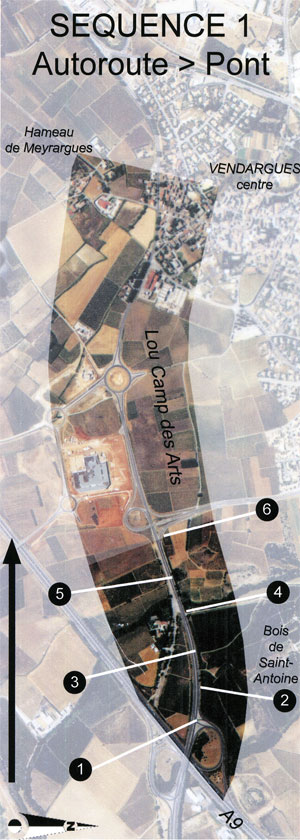 |
|
 |
| En se dirigeant vers le nord, nous quittons le système
linéaire de la nationale, pour rejoindre
deux des principales voies de contournement de l'agglomération :
D 65 et LIEN. Fin de la séquence 1. |
 |
| L'horizon est dominé par le pont de l'échangeur
avec la d épartementale 65. C'est une vraie porte paysagère :
au-delà, autre chose commence. Une direction secondaire peut être
prise, grâce à une bretelle de raccordement. |
 |
| Stabilisation de la pente de la route et horizontalité des
lignes du paysage perçu : l'horizon porte moins loin.
Léger
vallonement des champs sur le côté. Le franchissement
de la Cadoule se fait de manière « anonyme ». |
 |
| Réduction de l'emprise à 2 x 1 voie,
mais large bande d'arrêt et glissière de sécurité :
nous sommes toujours dans un registre routier. La nationale 113 a
retrouvé sa direction « naturelle » (plein ouest),
mais l'essentiel des pancartes pré-directionnelles engagent
l'automobiliste vers le nord (à droite). |
 |
| Large courbe orientant la route vers l'ouest. Découverte
de l'horizon marqué par les collines du Grès. Repère
fort : le château d'eau situé au hameau de Meyragues.
Percées visuelles furtives sur les quartiers est de Vendargues.
Présence d'un panneau publicitaire dénotant la qualité des
abords (par banalisation et mercantilisation) |
 |
| Accès depuis Baillargues ou en provenance de
Nîmes par I'A9. Typologie de voie à grande vitesse:
deux fois deux larges files, terre-plein central et longue voie d'insertion.
Boisements de part-et-d'autre. |
|
Enjeux de la séquence 1 : renforcer le caractère naturel des abords,
ménager des fenêtres sur le grand paysage, limiter le vocabulaire
routier trop prononcé.
 |
|
 |
|
L'objet routier « rond-point » monopolise
complètement la perception paysagère. En légère
pente, non végétalisé, occupant une vaste
emprise, le giratoire apparait comme un élément
« dur » et
artificiel du paysage Il annonce une troisième séquence. |
 |
| Un giratoire s'annonce à l'horizon. Le
chantier de sa construction (il y a plus de dix ans) est encore
lisible sur les bas-côtés (profond fossé et
talus dégarni). |
 |
| Assez vite, les abords de la route souffrent
de la présent visible d'objets disparates : vaste parking
du centre commercial au sud (avec voitures, grillage, mâts
d'éclairage), quelques pannonceaux publicitaires côté nord.
Les activités humaines sont lisibles, sans pour autant
que le paysage ne soit urbain. Une impression d'inachèvement
et d'inorganisation domine. |
 |
| La voirie revient pour la première fois
au même niveau que les terres environnantes. Cela donne
d'autant plus de force à l'ouverture de l'horizon sur
Vendargues. Seules les maisons construites depuis une dizaine
d'années apparaissent, mais l'homogénéité du
bâti et son épannelage (niveau des toitures) contribuent à conserver
l'image d'un village « blotti » autour d'un point
central. Ce point, seul élément historique visible,
est, en l'occurence, le cimetière et ses cyprès.
Chaque entité (urbaine ou naturelle) est visuellement
bien définie, les limites sont nettes, conférant
lisibilité au
paysage. |
 |
|
Après le franchissement,
l'horizon tarde à s'ouvrir et à prendre de la
consistance. Les abords sont très marqués par
l'infrastructure routière (glissière, voies d'enga-gement). |
 |
|
En continuant vers l'ouest, nous
franchissons un ouvrage d'art, correspondant au point de plus
faible largeur de la Nationale. Pour autant, les voitures roulent à 90
ou 100 km/h, rassurées par la glissière qui file.
La végétation sur les bas-côtés
est de type friche arbustive, non mise en valeur. Présence
d'un pylône électrique très visible. |
|
Enjeux de la séquence 2 : aménager la porte symbolique que constitue
le pont de l'échangeur, affirmer la transition du naturel vers l'urbain
(échelle géographique), favoriser la réduction graduelle
de la vitesse jusqu'au giratoire, préserver les relations visuelles
avec les signes remarquables de l'horizon.
 |
|
 |
| Le caractère fréquenté de
la voie et l'absence de traitement des abords (avec panneaux
publicitaires) nous laissent penser que l'on est en marge d'un
espace de vie : Vendargues ne profite pas de l'effet-vitrine
que peut favoriser la nationale 113. |
 |
| Malgré l'horizon dégagé au
sud (hameau de Meyrargues), la monotonie et la continuité des
murs encadrant la route, la ponctualité du bâti
et l'absence de trottoirs prolongent cette impression mitigée
d'hésitation entre urbain et naturel. |
 |
| L'alignement des platanes conduit tant bien
que mal à rééquilibrer visuellement les
abords de la route : il existe en effet une certaine dissension
entre les gros volumes de la cave coopérative à l'écart
de la route (nord) et le bâti modeste et hétérogène
accolé à la voie (sud). |
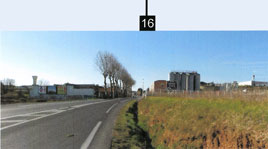 |
| Front urbain hétéroclite pour
l'entrée dans l'agglomération de Vendargues (cuves
industrielles de la cave côté nord, panneaux publicitaires
côté sud). C'est néanmoins le premier espace
un peu structuré que nous rencontrons depuis le début
du parcours (alignement de platanes). |
 |
| Énorme terre-plein central, mais aucun
trottoir ni aucun passage pour piétons. Le talus au
nord encaisse la route, les terrains au-dessus ne sont pas
visibles en voiture : autant de raisons qui font réaccélérer
les conducteurs au sortir du giratoire. |
 |
| Au sortir du rond-point, la vue porte loin :
sur le hameau de Meyrargues et sur le vallon séparant
Vendargues de Saint-Aunès. Les premiers bâtiments
de Vendargues - à commencer par la cave coo-pérative - apparaissent
encore lointains. |
 |
| Le premier accès direct dans le tissu urbain
de Vendargues se fait par le rond-point. Les abords ne sont pas
traités. Où se trouve-t-on ? en milieu urbain ?
ou en milieu naturel comme peut le suggérer l'horizon
dégagé ? |
|
Enjeux de la séquence 3 : rendre perceptible le caractère résolument
urbain de cette séquence (même si une large place doit être
faite aux aménagements végétaux), structurer le paysage
et la voirie, rendre lisibles les grandes directions partant du giratoire,
préserver les vues sur la colline de Meyrargues.
Retour au sommaire
PERCEPTIONS PAYSAGÈRES LOINTAINES
La topographie du secteur - avec des terrains très légèrement
en pente vers le sud - s'inscrit dans le schéma habituel de la plaine
languedocienne faisant la transition entre le littoral au sud et les reliefs
au nord. Le caractère ouvert de l'horizon et l'aspect non bâti
du site permettent des vues lointaines sur le grand paysage (Pic-St-Loup,
Grande-Motte, Château de Castries). Si l'urbanisation du secteur remettra
forcément en cause cet aspect, il conviendra néanmoins de ménager
des perspectives sur les éléments paysagers proches, comme
le Pioch Palat. Contre-exemple, à éviter : depuis la rue
Delacroix, la percée sur le bois de Saint-Antoine est maintenant occultée
par deux imposantes maisons.
Retour au sommaire
PERCEPTIONS PAYSAGÈRES
PROCHES
Le site offre des vues extrêmement ouvertes sur l'horizon. Aucune structure
paysagère végétale n'est décelable. Seuls les fronts
bâtis des lotissements et de la cave coopérative font sens entre
le sol et le ciel. Le caractère plat du site le rend vulnérable à la
moindre construction.
Mais la plaine viticole laissant progressivement la place à un
tissu construit, il conviendra sans doute de structurer cet espace ouvert
par des masses végétales et des alignements d'arbres. Pourra-t-on épargner
ce qui fait une des valeurs du site, à savoir sa remarquable ouverture
vers le ciel ?
Retour au sommaire
Trame viaire
LES DÉPLACEMENTS
Le Plan de Déplacements Urbains
La commune de Vendargues fait partie de l'aire d'étude du Plan
de Déplacements Urbains (P.D.U.) de l'agglomération de Montpellier.
Ce périmètre comprend 48 communes et 93 % de la population
de l'aire urbaine soit 429 000 habitants sur 670 km2.
L'aire du P.D.U. a été divisée selon les grands
ensembles cardinaux. La commune de Vendargues appartient à l'ensemble « Grand
Est (RN 113 - RN 110) qui représente 12,3 %
de la population totale et près de 26 % de la population hors
Montpellier.
À la différence des autres grands ensembles, l'ensemble « Grand
Est » n'est relié que par un seul axe majeur avec Montpellier
(ville centre), la RN 113, sur lequel se concentrent tous les flux
et qui traverse le territoire de Vendargues (où vient se piquer
la RN 110).
Les migrations alternantes :
Les migrations alternantes « Domicile - Travail » constituent
l'essentiel des déplacements.
On recense environ 48 500 migrants entrant ou sortant de la ville
centre dont près de 80 % de migrants vers Montpellier dans
des proportions assez voisines entre les grands ensembles cardinaux. Un
peu plus de 20 % des migrants sortent de la ville centre dont environ
2 500 vers le grand ensemble « Grand Est » soit
un quart du total des sortants.
La commune de Vendargues a vu sa position de pôle générateur
de déplacement se renforcer ces dernières années au
regard du nombre d'emplois nouveaux créés.
La voiture particulière est utilisée sur l'ensemble de
l'aire d'étude à plus de 80 % pour les déplacements
domicile-travail. Plus précisément sur Vendargues, les modes
de transport des actifs ayant un emploi sont répartis de la manière
suivante :
| Actifs ayant un emploi |
Nombre |
Part |
| Ensemble |
2 120 |
100 % |
| Pas de transport |
66 |
3,1 % |
| Marche à pied |
67 |
3,2 % |
| Un seul mode de transport : |
1 865 |
88,0 % |
| - deux roues |
76 |
3,6 % |
| - voiture particulière |
1 728 |
81,5 % |
| - transport en commun |
61 |
2,9 % |
| Plusieurs modes de transport |
122 |
5,8 % |
Source : INSEE 1999
Retour au sommaire
LA MOBILITÉ INTER-QUARTIERS
L'analyse de la trame viaire conduit à mettre en évidence
un certain enclavement du centre. Son accessibilité automobile depuis
la nationale 113 se fait de manière indirecte, les accès
n'étant pas aménagés et la traversée de Vendargues
n'étant pas mise en valeur.
 Depuis
les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied
ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre
limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée
des années 1960-1970 a créé autour du centre
une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables
qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau
jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire
bâti nécessite un passage obligé par le rond-point
du cimetière. L'accès à la place de la mairie
se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.
Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage
aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.
Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne
comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !! Depuis
les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied
ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre
limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée
des années 1960-1970 a créé autour du centre
une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables
qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau
jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire
bâti nécessite un passage obligé par le rond-point
du cimetière. L'accès à la place de la mairie
se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.
Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage
aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.
Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne
comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !!
Deux axes majeurs irriguent les quartiers construits depuis une
quinzaine d'années : la rue de la Monnaie (voie romaine
historique) et la continuité des avenues Pierre Mendès-France
et 8 mai 1945. Sillonnant le territoire d'est en ouest et
du nord au sud sur une longueur de près d'un kilomètre
chacune, ces voies se révèlent être plus à l'échelle
d'un déplacement automobile que piéton. Les quartiers
récents sont formés d'ilôts relativement fragmentés
qui permettent une bonne irrigation automobile, mais aussi piétonne,
du tissu urbain. Mais l'activité commerciale étant
quasi-exclusivement concentrée au centre, l'usage de la
voiture, faute de liaisons piétonnes rapides et sûres,
s'avère indispensable, compte-tenu des modes de vie actuels.
Il en va de même s'agissant de l'accès au centre commercial
St-Aunès.
Une des leçons à tirer de cet état de fait
est qu'il faudra valoriser, dans l'aménagement du secteur
Les Aires Vieyes, la moindre possibilité de liaison piétonne
menant directement au centre. |
Retour au sommaire
Réseaux
RÉSEAUX HUMIDES
Le reseau pluvial
Une étude hydraulique a été réalisée
par la Direction Départementale de l'Equipement en 1987 sur une
zone de 45 hectares dans laquelle se situe le secteur Lou Camp des Arts.
Elle a été effectuée dans le cadre du projet d'aménagement
d'une zone NAu du P.O.S. destinée à accueillir de l'habitat,
des commerces et des équipements publics.
|

Les calculs ont été effectués à l'horizon
du P.O.S. avec une morphologie urbaine supposée équivalente à celle
des secteurs voisins.
Les résultats et solutions proposées sont les suivantes :
- débit de pointe décennale prévisible :
6 m3/s
- canalisation de débit par un fossé en terre
le long de la R.N. 113 jusqu'à un bassin de rétention
situé au centre du carrefour giratoire : soit un
volume de rétention global de 4 300 m3 (fossé et
excavation centrale).
- canalisation du débit de fuite de 3,70 m3/s par
un fossé en terre sur la commune de Saint-Aunès
jusqu'au ruisseau de la Balaurie.
Au regard de l'ancienneté de cette étude et des
obligations fixées par la loi sur l'eau, l'urbanisation
du secteur Lou Camp des Arts a fait l'objet d'une étude
hydraulique spécifique. Les préconisations de cette étude
seront pris en compte dans le parti d'aménagement. |
Les réseaux d'eaux usées, d'eau potable et BRL
Le site ne pose pas de difficultés pour être raccordé aux
différents réseaux humides. Ces raccordements pourront s'effectuer à partir
des lotissements voisins déjà équipés. Les
réseaux
traversant actuellement le site pourraient être
reconsidérés en fonction du parti d'aménagement.
L'alimentation en eau potable est issue de la source du Lez.
La station d'épuration située à proximité du
site (au sud-ouest du rond-point) permet de traiter plus de 7000 équivalents-habitants
et pourra largement supporter l'augmentation de population .
Dans la cadre de la communauté d'agglomération de Montpellier,
la commune de Vendargues doit être raccordée au futur émissaire
en mer, via la station de la Céréreide (Lattes).
Pour le réseau d'irrigation (BRL), il faudra négocier l'abandon
des antennes qui ne sont plus utilisées ou prévoir une utilisation
pour les particuliers (jardins) ou les espaces verts.
Retour au sommaire
Sol
L'OCCUPATION DU SOL
Le site est actuellement occupé à 75 % par des friches
agricoles (certaines servent de pâturages), à 21 % par
de la vigne et le reste par des cultures céréalières.
Cet espace est marqué par la présence de quelques arbres :
des allées de Cyprès, des pins Pignon,... et surtout un superbe
chêne vert au nord-est en bordure de la R.D. 65 et du lotissement
du « Grand Chêne », qu'il convient de préserver
dans le cadre du futur aménagement.
Retour au sommaire
LA TOPOGRAPHIE
Vendargues s'inscrit dans la grande plaine du Bas-Languedoc avec des altitudes
variant entre 80 mètres au nord du territoire communal et une trentaine
de mètres au sud-est. Le site de la future Z.A.C. comprend les points
les plus bas de la commune.
Le secteur présente un relief composé de pentes douces
dans l'ensemble. Il se caractérise par deux orientations :
- une pente qui décline assez rapidement vers le sud/sud-est depuis
le carrefour entre la rue du 8 mai et le chemin de Saint-Antoine.
- une pente qui décline plus lentement vers le sud-ouest depuis le carrefour
du chêne vert (intersection entre le chemin de Saint-Antoine et la R.D. 65)
après un large secteur relativement plat qui domine tout le site.
Ainsi, la topographie varie entre 33 mètres (NGF) et 41 mètres
(NGF), soit un dénivelé de 8 mètres. La pente moyenne
est de l'ordre de 5 %.
Retour au sommaire
LE FONCIER
Le périmètre de la Z.A.C. concerne 42 parcelles non bâties
réparties entre une vingtaine de propriétaires sur superficie
totale d'environ 16 hectares (y compris voirie existante et emprises non cadastrées).
La répartition est la suivante :
Référence
cadastrale |
Superficie
approx. (m2) |
Référence
cadastrale |
Superficie
approx. (m2) |
Référence
cadastrale |
Superficie
approx. (m2) |
AE25 |
2 990 |
AE39 |
324 |
AE62 |
2 768 |
AE26 |
2 349 |
AE40 |
2 788 |
AE66 |
15 198 |
AE27 |
2 147 |
AE41 |
22 482 |
AE72 |
292 |
AE28 |
2 121 |
AE44 |
7 580 |
AE75 |
1 256 |
AE29 |
2 138 |
AE45 |
4 105 |
AE164 |
8 128 |
AE30 |
2 000 |
AE46 |
5 699 |
AE211 |
498 |
AE31 |
2 089 |
AE47 |
7 213 |
AE212 |
494 |
AE32 |
4 205 |
AE48 |
6 429 |
AE213 |
501 |
AE33 |
6 997 |
AE49 |
3 609 |
AE214 |
492 |
AE34 |
1 925 |
AE51 |
4 128 |
AE215 |
498 |
AE35 |
1 855 |
AE54 |
104 |
AE216 |
479 |
AE36 |
1 940 |
AE55 |
107 |
AE217 |
494 |
AE37 |
4 052 |
AE56 |
6 785 |
AE218 |
505 |
AE38 |
106 |
AE57 |
36 |
AE219 |
11 022 |
| Emprises non
cadastrées* |
7 290 |
TOTAL : |
159 278 |
Le site a un foncier relativement morcelé notamment au niveau du
chemin de Saint-Antoine, au nord du site, avec des parcelles en « lamelles » orientées
perpendiculairement au chemin et d'une superficie moyenne de 2000 m2.
Les parcelles les plus importantes se situent essentiellement au sud du
site et en bordure de l'avenue du 8 mai 1945 avec des superficies
variant de près
de 1 hectare à plus de 2 hectares.
À signaler une découpage de 8 parcelles d'environ 500 m2
en moyenne sur la partie nord-ouest du site correspondant à un lotissement
en attente d'une ouverture à l'urbanisation.
Retour au sommaire
Nuisances et contraintes
NUISANCES SONORES
LES NUISANCES SONORES
Le site est en bordure d'infrastructures routières bruyantes concernées
par l'Arrêté préfectoral n° 2001-1-975 qui
classe la RN 113 (au niveau du site) et la RD 65 en catégorie
3. Pour cette catégorie,
la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure est de 100 mètres. Dans cette bande sont
imposées
des normes de constructions.
En outre, une étude acoustique a été réalisée
par le bureau d'études Conseil Ingénierie Acoustique (CIA) de
Marseille afin de connaître la situation actuelle au niveau du site.
L'analyse de la situation initiale a été faite à partir
d'une modélisation par calcul. La carte de bruit (1) ci-dessus montre
l'impact acoustique à une hauteur de 1.5 m de la RD 65
et de la RN 113
en situation actuelle. Sur la zone du projet, les niveaux de bruit actuels
sont de l'ordre de 50 à 55 dB(A).
Trafics et vitesses
| |
SECTIONS |
VITESSE
km/h (1) |
%PL
(2) |
2000
v/j (2) |
2003
v/j (3) |
2003
v/h |
| RD65 |
Castries |
Échangeur RD65/RN113 |
50 |
3,2% |
15 597 |
17 043 |
947 |
Bretelle
vers RN113 |
nord
est |
50
50
|
3,2 %
3,2 %
|
3 899
3 899
|
4 261
4 261
|
237
237
|
Ouvrage sur RN113 |
50 |
3,2 % |
7 799 |
8 522 |
473 |
Bretelle vers RN113 |
ouest
sud |
50
50 |
3,2 %
3,2 % |
3 899
3 899 |
4 261
4 261 |
237
237 |
| RN113 |
Baillargues |
RD65 |
50 |
9,6 % |
25 346 |
27 696 |
1 539 |
RD65 |
Giratoire centre commercial |
50 |
9,6 % |
25 346 |
27 696 |
1 539 |
(1) données réglementaires
(2) données Spi Infra
(3) Calcul réalisé avec un taux de croissance de 3 %
Globalement, on peut dire que le projet se situe
dans une zone d'ambiance sonore préexistante modérée (LAeq actuel > 65 dB(A)).
Le futur projet d'urbanisation dans le cadre de la ZAC Pompidou devra
donc préciser les contraintes acoustiques sur la zone à bâtir
pour les futurs promoteurs (les maîtres d'ouvrage de projets immobiliers
en bordure d'infrastructure importante sont tenus de mettre en place des
protections contre le bruit - de par l'antériorité de la route
par rapport au bâti, ce n'est plus au maître d'ouvrage de l'infrastructure
de mettre en place des protections).
Le projet de ZAC doit donc, en fonction des contraintes, définir les
mesures pour réduire le bruit dans l'environnement (2).
(1) Le bruit est dû à une variation
de la pression régnant
dans l'atmosphère. L'onde sonore faisant vibrer le tympan résulte
du déplacement d'une particule d'air par rapport à sa position
d'équilibre. Cette mise en mouvement se répercute progressivement
sur les particules voisines tout en s'éloignant de la source de
bruit. Dans l'air, la vitesse de propagation est de l'ordre de 340 m/s.
On caractérise
un bruit par son niveau exprimé en décibel (dB(A)) et par
sa fréquence (la gamme des fréquences audibles s'étend
de 20 Hz à 20 kHz).
(2) La réduction du bruit dans l'environnement porte sur la conception
de source de bruit moins gênantes (véhicule moins bruyant
mais toujours plus nombreux, amélioration des revêtements
de chaussée
pour les routes...), la mise en place de barrières acoustiques (écrans
acoustiques, merlon de terre...) et enfin isolation de façade des
bâtiments
(ce dernier recours consiste à assurer un isolement important à un
logement en mettant en place des menuiseries performantes au niveau acoustique).
Retour au sommaire
CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Le zonage :
Le P.O.S. de Vendargues a été approuvé le 23 mai
1980 et a subi depuis cinq modifications et une révision simplifiée
afin d'ouvrir progressivement des zones à urbaniser.
Les ouvertures à l'urbanisation des zones NA ont successivement fait
l'objet d'études et de schémas d'organisation.
Le document d'urbanisme doit faire l'objet d'une révision simplifiée afin
d'intégrer le futur projet de ZAC dont le site est actuellement classé essentiellement
en NAf2 et, pour l'extrémité ouest, en UE, des zones qui ont
vocation a accueillir des activités économiques.
Les servitudes d'utilité publique et les mesures de protection :
Le site de la ZAC est concernée par plusieurs servitudes d'utilité publique :
- T4-T5 : servitudes aéronautiques de dégagement
et de balisage
- AC1 : servitudes liées à l'inscription aux monuments
historiques de l'église Saint-Antoine de la Cadoule située
sur la commune de Baillargues et dont le périmètre de protection
concerne l'extrémité est du site.
- A2 : servitudes attachées à l'établissement
de canalisations souterraines d'irrigation (réseau BRL non reporté sur
le plan des servitudes du POS)
Les dispositions concernant la servitude 14, lié au passage d'une
ligne électrique de haute tension (au sud-est du site), ont été abrogées
par un décret du 23/09/1999.
La servitude PM1 relative au Plan de Prévention des Risques d'Inondations
(approuvé par arrêté préfectoral en date du
14/08/2003) ne concerne pas le site.
| Extrait du plan des servitudes d'utilité publique |
|
Les sites archéologiques :
Aucune découverte archéologique n'est actuellement recensée
sur le site par les services de la DRAC (source : Porter à connaissance
en date du 24/12/2002).
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE MONTPELLIER
Le projet doit être compatible avec les orientations du SCOT. Ainsi,
dans le document d'orientations générales, la commune de Vendargues
appartient au secteur « Cadoule et Bérange ».
Le site de la ZAC appartient aux zones d'extensions urbaines prévues
par le SCOT sur la commune. Il préconise un niveau d'intensité de
plus de 20 logements à l'hectare ou plus de 2000 m2 de SHON par hectare
(niveau d'intensité C).
Retour au sommaire
Vers section suivante
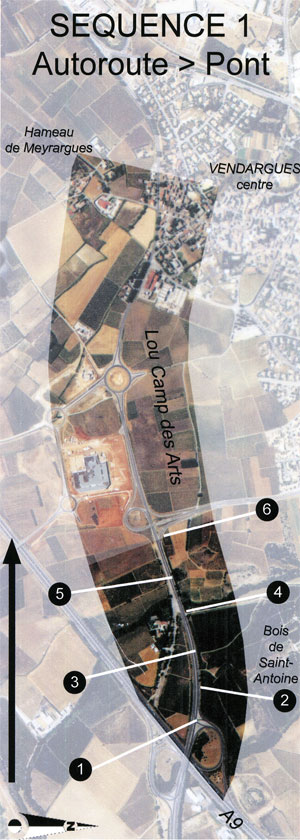

















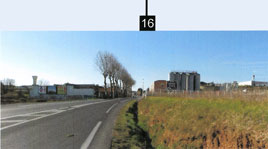






 Depuis
les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied
ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre
limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée
des années 1960-1970 a créé autour du centre
une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables
qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau
jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire
bâti nécessite un passage obligé par le rond-point
du cimetière. L'accès à la place de la mairie
se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.
Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage
aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.
Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne
comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !!
Depuis
les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied
ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre
limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée
des années 1960-1970 a créé autour du centre
une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables
qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau
jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire
bâti nécessite un passage obligé par le rond-point
du cimetière. L'accès à la place de la mairie
se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.
Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage
aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.
Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne
comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !!